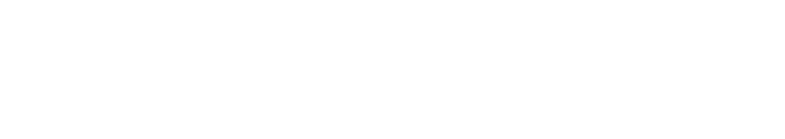Presse
L’eau tremblante des saisons
Extraits
Joëlle Gardes poursuit sa passionnante carrière de créatrice, après plusieurs livres de romans, de poésie, de théâtre, de composition à plusieurs voix ou avec du visuel. Dans ce nouveau recueil, sa voix à elle se fait entendre plus simple, plus nette, plus pure — plus constamment tragique.
Ce sont des textes généralement courts, la plupart descriptifs, au présent, à la troisième personne. On retrouve la thématique préférée de J. Gardes : les jardins, les paysages, le bord de mer, les saisons. Elle s’attache au général et à l’infime, à l’infime dans le général, au général totalement rempli par l’infime. Elle ne cesse de dire le temps qui passe, et aussi la disparition lente et inexorable de sa mémoire, jusqu’à la diminution, la perte et l’abolition de soi-même (d’où la rareté du je dans cette poésie en prose, si congruente à cette atmosphère). De nombreux textes illustrent, chacun sous un instant particulier, cette précieuse impossibilité de capter la métamorphose ou l’évolution éternellement recommencées et triomphantes dans la nature ; cette écriture, au moins comme geste, en porte la stèle.
[…] Certaines lectrices seront sans doute sensibles aux textes les plus poignants, les plus chargés d’émotion personnelle lourde et partageable, surtout écrits sur le mode impersonnel : les terribles descriptions, de l’intérieur en ruine, du corps et de la personne gravement malades, sous le regard ou sans le regard d’autrui, de ses (faux) proches.
C’est que tout le recueil exemplifie un magnifique thrène de la mort, dans l’expression de l’insupportable contradiction entre le temps toujours renaissant de la vie extérieure (un temps qui n’est pas le mien), et le temps de soi dont la vie a l’odeur et la palpitation de la mort. La beauté est aussi absolue qu’inutile ; ce tragique est emblématisé par la posture d’un texte narratif-descriptif sur l’existence d’une chatte, vieillissante et épileptique, qui se termine, alors qu’il est finalement question du regard de l’animal, par l’ajout-détachement de la seule indication subjective du texte : Son regard […] le mien.
On l’aura compris : c’est le chant du lyrisme de notre modernité, désespéré et tragique, à ras la peau, sans pathos et sans larmes.
Georges Molinié, Europe , janvier 2013
Ces poèmes, sous leur déguisement de « prose », mais non ponctuée le plus souvent, avancent leur propos selon une prosodie si juste, tellement impeccable, qu’elle en devient comme le symbole même de « l’implacable » dont ils nous entretiennent par le démontage impitoyable de nos éventuelles illusions. […]
Qu’elle évoque tel sentiment d’abandon, sensible dès la petite enfance, un séjour à l’hôpital, une femme diminuée par l’âge et la maladie, un amical repas par une « soirée d’été » où chacun s’efforce, dans la douceur de l’heure, d’oublier qu’un des participants, malade, sait devoir quitter plus tôt que les autres la table du banquet… qu’elle énumère les seuls prénoms de quelques suicidées célèbres par la littérature – ayant rejoint dans l’eau du désespoir « celle qui s’est jetée dans la citerne »-, ou qu’elle discerne un « appel à l’aide […] dans le regard de la chatte noire » vacillante et en fin de vie, Joëlle Gardes parvient à nous faire partager, par un travail de grande précision stylistique – un « lyrisme haute définition » si l’on peut risquer cette formule – la conviction du désenchantement qui la laisse inconsolée.
André Ughetto
Revue Phoenix n° 7, octobre 2012
De « cet art de pudeur et de modestie », définition du classicisme selon Gide, naît une émotion poignante, bouleversante quand surgissent les forces du désordre : le je qui ne peut plus se taire, « j’efface rageusement les coulées les taches le rouge violent de la bouche sur le visage où le temps a déposé son masque / masque de la peur / de la vie, » le réalisme cru de la souffrance subie dans la maladie (« L’esprit flotte au-dessus du corps / la goutte qui tombe dans les veines scande un temps de passivité et d’attente / un temps inhumain »), mais aussi le bonheur aigu d’être en vie, la jouissance sensuelle de la vie : « bain dans la mer glacée des lendemains de mistral / quand l’eau tiède est repoussée au large et que les sources froides affleurent à la surface / frisson délicieux indécision entre plaisir et déplaisir. » Alors le lyrisme personnel l’emporte et s’élève le chant élégiaque : une élégie sans complaisance, sans pathétique, dans la tonalité des Élégies de Duino, dans leur dimension métaphysique, panthéiste. « Dorénavant je prierai les divinités des vagues avant d’entrer dans la mer, je jetterai le sel par-dessus mon épaule gauche et verserai le lait sur le seuil de ma maison, / sans culpabilité ni crainte, / dans la sérénité de ceux qui ont renoué l’alliance avec les choses. »
Bien que maîtrisée et retenue, l’angoisse contemporaine face à un monde sans rédemption sourd de L’Eau tremblante des saisons. Angoisse à laquelle Joëlle Gardes apporte sa réponse personnelle : celle d’une quête inlassable du dépouillement et de la disponibilité au monde, qui permet de ressentir parfois l’apaisement en acceptant l’infinie patience humaine.
L’écriture classique de Joëlle Gardes pourrait être définie par les mots que l’un des plus grands peintres contemporains appliquait à son œuvre : « le bruit caché dans le silence, le mouvement dans l’immobilité, la vie dans l’inanimé, l’infini dans le fini, des formes dans le vide et moi-même dans l’anonymat » (Joan Miró).
Françoise Donadieu, sur le site de terres de femmes, 21 juillet 2012
www.terresdefemmes. com